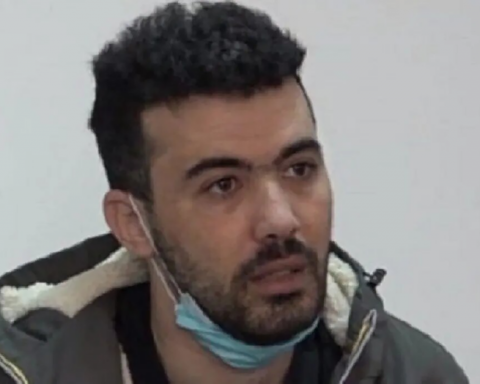DJAMEL ZENATI in EL WATAN 18 AOÛT 2016
L’évocation du Congrès de la Soummam ne manque jamais de susciter des interrogations et de soulever des débats parfois passionnés.
Et pour cause, l’événement se confond avec son principal concepteur, Abane Ramdane, et son destin tragique, l’élimination physique. La date du 20 août 56 dérange, agace, dévoile les embarras et les hypocrisies, les reniements et les hésitations. L’aversion pour ce rendez-vous historique va des gouvernants jusqu’à une partie de l’opposition.
A titre d’exemple, le texte de Mazafran autour duquel est réunie la CLTD a «omis» de référer à la plate-forme de la Soummam sur veto islamiste. La résurgence récursive des polémiques et des réflexes d’il y a soixante ans révèle notre impuissance à trancher de manière claire et irrévocable une question fondamentale : quelle Algérie voulons nous ?
Cette modeste contribution ambitionne de revisiter l’événement, d’en extraire le sens et tentera de comprendre dans quelle mesure il a pu impacter les évolutions ultérieures.
Parler du passé est délicat et comporte d’énormes difficultés. Traiter d’un événement historique à la manière d’un fait divers expose à la réduction et au subjectivisme. Dans cette approche, le jugement l’emporte sur le sens.
Par ailleurs, nous nous démarquons de la tendance, de plus en plus en vogue, à la communautarisation de la mémoire et de l’Histoire. Avec ses moments de gloire et ses séquences obscures, du reste dialectiquement liés, l’Histoire est un tout. Elle nous impose d’assumer cette totalité et de nous éloigner des constructions fragmentaires, mystifiantes et conflictuelles.
L’ÉVÉNEMENT
Au moment où la rencontre historique d’Ifri ouvrait enfin de nouvelles perspectives révolutionnaires, un mouvement de forte inertie se cristallise pour figer la Révolution dans une pensée pauvre et sommaire et des structures éculées et inopérantes.
Pour des chefs à majorité socialisés dans la culture du factionnalisme, de l’intrigue et de la force, il est impensable de sacrifier aux principes de clarté, de rationalité et d’émancipation. L’engagement révolutionnaire a ses limites.
Cet événement va libérer l’ensemble des forces en rapport direct ou indirect avec la question algérienne. La dynamique libératrice se trouvera alors prisonnière d’un enchevêtrement de stratégies, internes et externes, en continuelle interférence, s’opposant ou entrant en résonance selon la nature des enjeux et les intérêts des uns et des autres.
L’assassinat de Abane est la conséquence de ce conflit à polarité multiple. Les raisons profondes et les motivations étant inavouables, les parties en présence, de connivence ou en convergence objective, s’attacheront avec résolution à réunir les éléments constitutifs d’une légitimation a posteriori d’un crime abject aux conséquences désastreuses.
ABANE VICTIME DE SON AUTORITARISME
Les années 1955 et 1956 ont été marquées par un faisceau d’événements d’une importance sans égale. Indépendance du Maroc et de la Tunisie, découverte du pétrole à Hassi Messaoud, négociations secrètes entre le FLN et des représentants du pouvoir français, conférence de Bandung, premiers signes de la crise de Suez, pacte de Baghdad vont alors s’entrecroiser et donner un coup d’accélération à l’histoire. Cela augurait d’un bouleversement profond dans la problématique algérienne et laissait entrevoir un durcissement de la position coloniale. Cette conjoncture particulière n’a pas échappé à la vigilance de Abane, Ben M’hidi et les autres. Usant de leur capacité d’anticipation, ils se mirent à l’œuvre.
Pressé d’en finir avec une situation coloniale intenable et confronté aux limites d’un nationalisme segmenté et à la stratégie approximative, Abane choisit le traitement de choc. Est-ce vraiment faire choix devant une situation bloquée ? Il lui fallait mettre du sens dans le mouvement, de l’unité dans la dispersion, du souffle dans l’action et de l’ordre dans l’anarchie. Il le fit non sans difficulté, avec autorité mais sans aucune velléité autoritaire. Il était un homme d’autorité et non un homme autoritaire.
Son attitude ferme et intransigeante est réelle. Mais elle l’est d’abord envers lui-même. Elle est ensuite dictée par les contingences du moment. Elle est enfin l’effet d’un excès de pédagogie mêlé à un sentiment d’exaspération face à l’indigence intellectuelle caractérisée de responsables grisés par la seule soif du pouvoir. Si Abane a été assassiné pour la dureté de ses comportements, que dire alors de ses assassins ?
ABANE VICTIME DE RIVALITÉS
A travers ses écrits, Khalfa Mameri dévoile nombre d’aspects de la personnalité de Abane et révèle les détails de sa liquidation. Le style dont use l’auteur de Abane Ramdane, le faux procès laisse transparaître de la sincérité, de l’émotion et une indignation légitime.
Toutefois, en s’enfermant dans la perspective d’une herméneutique de surface, Khalfa Mameri se prive d’éléments indispensables et décisifs à même de restituer à ce crime son sens entier.
En effet, sa démonstration se fonde essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur la note d’Ouamrane rédigée à Tunis le 15 août 1958 et adressé à ses pairs du CCE. La pensée profonde de Abane et le sens lointain de sa vision n’ont pas bénéficié d’une expertise poussée. Le résultat auquel il a abouti porte les limites de cette démarche. Dans l’introduction à la troisième édition augmentée du livre Abane, le faux procès, il écrit : «Je ne vois d’autre explication au meurtre de Abane Ramdane que celle d’une rivalité implacable, impitoyable pour contrôler la Révolution et devenir plus tard le chef de l’Algérie indépendante.»
Mameri n’est pas dans le faux. Mais sa conclusion est de faible véridicité. En effet, si l’objectif de Krim est de se débarrasser d’un rival potentiel, il en est différemment de Boussouf. Ce dernier n’est pas dans une démarche individuelle, il prend ses ordres ailleurs. En définitive, Krim et Boussouf, consciemment ou inconsciemment, agissent pour le compte d’une partie invisible. Celle-ci, très au fait des rivalités, les attise et les utilise à son propre profit. Le conflit opposant Abane à cette partie invisible est d’ordre stratégique. Il porte sur la nature du futur Etat algérien.
Par ailleurs, notre étonnement fut grand à la lecture de certains passages de son livre. Parlant de la note d’Ouamrane, Mameri écrit :
«A ma connaissance, ce document n’a jamais été évoqué, encore moins publié dans aucun des ouvrages qui ont traité de la guerre d’Algérie. J’ai le redoutable privilège d’en parler pour la première fois. […] Tous ceux qui ont lu le document en question, en fait un petit nombre de personnalités (moins d’une dizaine), m’ont fortement recommandé de ne pas le publier. […] cela risquait de déclencher une tempête en Kabylie».
Ces propos appellent de la précision. Tout d’abord, et contrairement à l’affirmation de Mameri, ce document a déjà été évoqué par Yves Courrière. Dans son livre L’heure des colonels, troisième tome d’une série consacrée à la guerre d’Algérie et paru aux éditions Fayard en 1970, ce journaliste et grand reporter de guerre reproduit de larges extraits du fameux document . Dans la note 1 figurant en bas de la page 187, il précise : «Ce dialogue, ainsi que les circonstances de la mort de Abane, sont tirés du seul document existant sur le fait mystérieux révélé ici pour la première fois. Il s’agit d’un rapport ultra-secret envoyé aux membres de CCE et rédigé par l’un d’entre eux le 15 août 1958 à Tunis».
Khalfa Mameri pouvait-il ignorer l’existence de ce livre ? Il s’agit probablement d’un oubli par méconnaissance, loin de toute tentation à usurper un droit de primeur.
Enfin, la dramatisation excessive avec laquelle est entourée la question de l’opportunité de la publication du document laisse pour le moins perplexe. Pourtant, le document ne comporte rien, absolument rien qui puisse justifier autant d’inquiétude. Deux lectures possibles. Ou bien Mameri est en quête du sensationnel, ou alors suggère-t-il la thèse d’une élimination de Abane pour délit d’appartenance à la Kabylie. Cette seconde hypothèse mérite une attention particulière.
En identifiant Abane par le seul marqueur kabyle, Mameri semble adopter l’approche culturaliste. Continuons la démarche en nous intéressant cette fois-ci au commanditaire. Le rapport d’Ouamrane se clôt par la phrase suivante : «Il est à noter qu’un élément dont le nom sera révélé au moment opportun m’a fait savoir à Beyrouth que Abane a été exécuté par Boussouf sur ordre de Krim».
En langage culturaliste, cela se traduit comme suit : il a été révélé à Ouamrane, un Kabyle, que Abane, un autre Kabyle, a été exécuté sur ordre de Krim, encore un Kabyle. Le raisonnement culturaliste tombe en ruine.
LES MISÉRES DU FACTIONNALISME
Cela nous autorise-t-il pour autant à conclure à l’inexistence du régionalisme ? Absolument pas. Le sentiment anti-kabyle existe, de même son symétrique, le sentiment anti-arabe. Seulement, se hasarder à expliquer l’un par l’autre expose au problème de circularité, à l’impasse du cercle vicieux. La raison est simple : les deux sont produits par une même cause et ne possèdent pas de logique propre. Dans une large mesure, c’est le factionnalisme qui crée le régionalisme et non l’inverse. Le régionalisme ne se confond pas avec le sentiment d’appartenance régionale. Le régionalisme naît de l’utilisation de ce sentiment comme ressource politique dans la compétition pour la conquête du pouvoir ou du leadership. Il est le mode d’affirmation d’élites impatientes et à la vision atrophiée. Pouvait-il en être autrement au regard des conditions de l’époque ? Le factionnalisme, adossé au régionalisme, rend compte de l’état de la société, de ses pesanteurs sociologiques. Il renvoie aussi à un contexte d’impasse politique indépassable dans le cadre d’un rapport de domination.. L’islamisme obéit au même schéma. Certaines évolutions récentes observables dans plusieurs régions du pays et du monde semblent également emprunter la même voie.
Aujourd’hui, nombreux sont les politiques à puiser dans le registre des solidarités primordiales. A commencer par le pouvoir lui-même. L’irruption fulgurante des identifications particularistes (chaoui, kabyle, m’zab, tergui, el gharb, echarq, etc) porte la signature de l’incapacité génétique de l’autoritarisme à apporter une réponse rationnelle à la question de l’intégration nationale.
ABANE FACTIONNALISTE ?
Abane était-il un adepte du factionnalisme ? Assurément non. Ayant parfaitement compris la réalité du phénomène, Abane l’a intégré, peut-être même s’en est servi, dans la perspective de le dépasser. Soustraire la Révolution à l’enfermement factionnel exige une implication plus directe de la société dans le mouvement de libération. D’où les nombreuses initiatives de Abane en direction des travailleurs, commerçants et étudiants. «Jetez la Révolution dans la rue, le peuple s’en emparera», disait à juste titre Larbi Ben M’hidi.
Enfin, est-il raisonnable de suspecter de factionnalisme l’homme qui s’est résolument employé à rallier l’ensemble des formations politiques aux thèses frontistes ? Abane est inclassable. En effet, selon le critère retenu, il est tantôt dans un clan et tantôt dans un autre et parfois nulle part. Il incarne, sans le vouloir, une sorte de synthèse. Son erreur a été de sous-estimer la puissance redoutable et la force de résistance du factionnalisme.
Le point faible majeur de la plate-forme de la Soummam se trouve justement dans son aspect politique. C’est-à-dire dans la nature et la structure des forces politiques censées la porter.
LA MAIN ÉTRANGÈRE
La vigueur et l’intensité du fait régionaliste dans le mouvement national ne sauraient s’expliquer sans l’action idéologique de la France et de l’Egypte. En effet, la «politique de division» de la France et la «politique arabe» de l’Egypte se sont subtilement accordées pour faire d’une diversité culturelle et politique enrichissante une frontière infranchissable et un clivage destructeur.
Des clichés fictifs et déformants sont façonnés et distillés pour égarer les acteurs et brouiller les représentations sociales. Le cas de l’Egypte nous interpelle particulièrement au regard de l’objet de notre contribution.
Pour les dirigeants égyptiens, de l’aveu même de Fethi Al Dib, haut dirigeant égyptien, les Kabyles sont suspects car insuffisamment imprégnés de l’idéologie nassérienne et trop attachés à leur tribalisme. Pour autant, les Arabes ne trouvent pas tous grâce à leurs yeux. Il y a les bons et les mauvais Arabes. Pour les Egyptiens, Ben Bella est l’incarnation parfaite du bon Arabe. Son enthousiasme pour l’idéologique nassérienne et sa vénération sans limite pour le Raïs font de lui le meilleur garant d’une allégeance de l’Algérie à l’Egypte. Adoubé et cajolé, il bénéficiera de tous les soutiens afin d’asseoir son hégémonie sur la Révolution. Tout cela avec l’appui discret de la France.
Dans un entretien au journal Liberté publié le 7 novembre 2002, la veuve de Abane raconte : «Après l’arraisonnement de l’avion en 1956, les cinq dirigeants du FLN ont été amenés à Alger. Sur le bitume de l’aéroport, Mohamed Boudiaf tenait un porte-documents entre les mains. Un gendarme s’est avancé vers lui, le lui a pris des mains pour le remettre à Ahmed Ben Bella. A ce moment-là, un flash a crépité pour immortaliser l’instant». Pourquoi, demande alors le journaliste ? Madame Abane poursuit : «Pour faire croire que c’est Ben Bella le premier dirigeant. Cette anecdote m’a été racontée par Boudiaf lui-même. Il avait compris que la France voulait donner un chef à la Révolution algérienne, le plus bête des chefs. C’est la dernière farce que la France nous a faite.
Ben Bella était un grand inconnu en 1954».
En revanche, Abane fera l’objet d’une campagne de diabolisation sans bornes. Pour les Egyptiens, il constitue un obstacle à l’ascension de Ben Bella et par ricochet, au dessein algérien de Nasser, à savoir la mise sous tutelle égyptienne de la Révolution et du futur Etat algérien. Il sera alors vilipendé et chargé de toutes les «tares» : Kabyle, marxiste, religiosité incertaine, occidentaliste, autoritaire, etc. Quant aux Français, ils voient en Abane le dirigeant cultivé, le souverainiste intransigeant et l’interlocuteur difficile. Ce n’est certainement pas l’homme qu’ils souhaiteraient voir présider aux destinées de la Révolution et encore moins de l’Algérie indépendante. La France est dans une double logique : maintenir le rapport colonial ou, le cas échéant, exercer un contrôle sur l’Algérie à partir d’une intermédiation sûre.
ABANE VICTIME DE SON OCCIDENTALITÉ
Dès l’adoption de la plate-forme de la Soummam, des voix s’élèvent pour crier au déviationnisme. Cette fois l’accusation emprunte au registre du symbolique et du sensible. Dans ses mémoires, Lakhdar Bentobal rapporte : «Les Egyptiens, quand ils avaient pris connaissance du texte de la Soummam, avaient dit qu’il s’agissait là d’une déviation de la Révolution et que c’était plus du marxisme que du nationalisme».
La sentence égyptienne n’est pas partagée par certains observateurs pourtant mieux avertis et plus crédibles en la matière. Dans son ouvrage Quand l’Algérie s’insurgeait, Daniel Guérin, figure de proue d’une tendance de l’extrême gauche française et grand militant anticolonialiste, écrit à propos de la même plate-forme : «Elle est essentiellement patriotique et militaire, privée de tout contenu social, pour ne pas dire socialiste».
Cette énorme différence d’appréciation s’explique facilement. Les Egyptiens ne sont pas dans la lecture critique mais dans la manœuvre. Elle consiste à réveiller les vieux démons en ressuscitant l’ancienne accusation de berbéro-matérialisme sous une forme rafraîchie : le kabylo-marxisme.
Le réquisitoire contre Abane ne s’arrête pas là. En effet, dans ses mémoires, Fethi Al Dib, ancien chef du renseignement égyptien chargé des relations avec le FLN durant la guerre d’Algérie, déclare : «Dans ses idées et ses points de vue sur l’avenir de l’Algérie indépendante, Abane avait ignoré son appartenance arabe et islamique, ce qui constituait une déviation par rapport aux principes énoncés dans la Constitution du 1er novembre 1954».
Ben Bella, dans une prose similaire et sur un ton menaçant, exprime exactement le même grief. Dans une lettre adressée à la direction exécutive du FLN à la fin de l’automne 56, il écrit : «Ces décisions remettent en cause des points doctrinaux aussi fondamentaux que celui du caractère islamique de nos futurs institutions politiques. […] Ce serait prendre des risques très graves que de les rendre publiques».
Pourtant, en définissant le combat libérateur comme «une lutte nationale pour détruire le régime anarchique de la colonisation et non une guerre religieuse», la plate-forme de la Soummam reprend un principe déjà consacré par le passé.
Car au plan doctrinal, et plus précisément sur le rapport de la Révolution à l’islam, rien ne distingue la plate-forme de la Soummam du programme du MTLD, lequel définit la Révolution comme suit : «Ce n’est plus le musulman qui s’oppose au chrétien, mais c’est le colonisé qui s’oppose au colonisateur. […] Le colonialisme, dans des buts qu’il est inutile de répéter, ne cesse de vouloir confondre nationalisme algérien et islam. Il est alors facile de crier au fanatisme, à l’esprit périmé et statique contraire aux concepts de la vie moderne».
Au-delà de l’effarouchement tardif de Ben Bella, sa communauté de vue avec les Egyptiens exprime une prétention forte au leadership enchâssée à une stratégie égyptienne beaucoup plus large, à savoir la satellisation du monde arabe autour du projet mythique égyptien de la grande nation arabe et islamique.
En apparence, entre Nasser et Ben Bella se développe un rapport de maître à disciple. La réalité est autre. Nous sommes en présence d’une relation transactionnelle.
Cet épisode pose néanmoins une question d’importance : notre rapport aux autres et plus particulièrement à l’Occident.
L’OGRE OCCIDENTAL
La référence aux catégories politiques et juridiques de type occidental est antérieure à Abane. Elle remonte au début du XXe siècle et elle est repérable dans les écrits et discours des pères fondateurs du nationalisme algérien tels Imache Amar, Messali Hadj et beaucoup d’autres. De plus, il serait erroné de voir dans cette démarche une appropriation mécanique, une importation brute d’un modèle sous l’effet d’un supposé penchant occidentalisant. Beaucoup de facteurs concourent à expliquer ce recours. Nous en citerons trois.
Le premier facteur est un phénomène fondamental à l’œuvre dans le nationalisme algérien, à savoir la construction en miroir inversé. Il renvoie à la dominance du principe d’opposition au sens du schéma actionnaliste de Touraine. Aspect largement développé par Slimane Chikh dans son livre L’Algérie en arme». Ce phénomène impactera par ailleurs fortement la vision des élites dirigeantes sur diverses questions, notamment le volet identitaire.
Deuxième facteur non moins important est l’absence de tradition étatique et institutionnelle autonomes. Le soulèvement de l’Emir Abdelkader ne saurait être interprété comme le signe d’une conscience nationale. Il est l’expression d’un patriotisme local, loin de toute perspective en termes d’Etat ou de Nation. Il est certes précurseur, mais non fondateur.
Enfin, on ne peut ignorer la nature hégémonique de la catégorie «Etat-nation» et son caractère structurant dans le rapport international. Est-ce un hasard si les premières manifestations de la conscience nationale sont apparues dans les milieux de l’émigration ?
En retenant de l’Occident son seul côté impérialiste, du reste rejeté par les opinions occidentales elles-mêmes, les nationalistes radicaux occultent son apport décisif à la civilisation humaine. Ils jouissent et se réjouissent de ses productions matérielles tout en dédaignant ses réalisations en matière de droits de l’homme et de rationalité politique, scientifique et économique. Ils sont dans un rapport schizophrénique avec l’Occident.
En considérant les phénomènes de modernité et d’universalité comme des objets étrangers, des élaborations exclusivement occidentales, ils se placent de facto à la marge du mouvement de l’humanité et forgent eux-mêmes les instruments de leur propre asservissement. Le bilan désastreux du système mis en place et des politiques mises en œuvre au lendemain de l’indépendance en est la preuve. L’islamisme, alternative visible et prévisible à l’autoritarisme nationaliste, s’inscrit dans cette même logique. Dans un livre à paraître à Georgetown University Press en janvier 2017, Addi Lahouari consacre de longs développements à cette problématique.
Si être musulman consiste à aimer son prochain, accepter l’autre, venir en aide aux démunis, faire preuve de tolérance, dénoncer l’injustice, combattre la corruption, bannir l’abus de pouvoir et respecter la femme, alors l’islam est en Occident. N’en déplaise aux tenants du nationalisme et de l’islamisme, c’est la stricte réalité. Au fond d’eux-mêmes, ils en sont convaincus. Khomeiny, Ghannouchi, Haddam et autres Kébir ont choisi sans hésitation aucune les capitales occidentales comme terre d’asile. Ce n’est certainement pas pour leur climat. Il en est de même des nos dirigeants actuels. Ils nous gavent de nationalisme tout en ayant le regard et le cœur rivés sur Paris, Madrid, Londres, New York et ailleurs.
Modernité et universalité ne sont pas l’apanage du seul Occident. Jusqu’au XIIIe siècle, le Maghreb et le Machreq ont été à l’avant-garde dans la production du sens, du savoir et de la technologie. Est-il besoin de rappeler que l’essor politique, scientifique et technologique de l’Occident s’explique en grande partie par une appropriation dès la fin du moyen-âge des savoirs élaborés à Baghdad, en Mésopotamie, en Berbérie, en Egypte et ailleurs ?
S’inscrire dans la modernité et contribuer à l’universalité passe obligatoirement par la consécration effective des libertés, l’acceptation d’un dialogue permanent avec les autres cultures et la participation au mouvement incessant de transmission des expériences humaines. Le repli, identitaire ou autre, condamne à la régression avec son lot de déchéance culturelle, de domination politique et de dépendance économique.
Aussi, il est de l’ordre de l’impératif d’élaborer une critique globale du monde présent à l’aune de laquelle s’ébauchera une nouvelle perspective nationale. Comme il est tout aussi urgent de repenser le rapport de notre société à la religion et définir les conditions d’une sécularisation adaptée.
Abane a parfaitement saisi l’enjeu. La plate-forme de la Soummam en porte d’ailleurs l’empreinte. En effet, la nature et les objectifs de la Révolution sont définis dans une perspective nationale, moderne et universelle. «C’est une marche en avant dans le sens historique de l’humanité et non un retour vers le féodalisme. C’est enfin la lutte pour la renaissance d’un Etat algérien sous la forme d’une République démocratique et sociale et non la restauration d’une monarchie ou d’une théocratie révolues», peut-on lire dans le texte d’août 1956.
A travers Abane et ses détracteurs, ce sont deux conceptions de l’Algérie qui s’affrontent. Une Algérie libre, souveraine, ancrée dans la modernité et inscrite dans l’universalité. Et une autre, otage de l’autoritarisme et prisonnière de la pensée rétrograde et des pesanteurs communautaristes.
Abane a été éliminé en raison de sa vision de l’Algérie indépendante. Sa conception de la souveraineté et l’Etat contrarie des ambitions et des desseins. Dans ce qui suit, nous tenterons de donner un peu de visibilité à sa démarche. Quelques rappels historiques sont nécessaires.
REPÈRES THÉORIQUES
L’Etat-nation est une forme spécifique de collectivité politique inhérente à la contingence européenne après le moyen-âge. Mais pour diverses raisons, il est devenu hégémonique et a pris un caractère universel. L’essor planétaire fulgurant du capitalisme en est incontestablement la détermination la plus forte.
Au-delà de la singularité liée aux conditions concrètes propres à chaque expérience, un trait commun caractérise l’ensemble des processus de construction de l’Etat-nation. Il s’agit du mouvement de double transfert de souveraineté sans lequel la collectivité politique ne saurait exister ni s’affirmer. C’est la logique westphalienne. Hobbes et Bodin sont les premiers à avoir repéré et parfaitement décrit ce phénomène. Le premier transfert de souveraineté s’opère des micro-pouvoirs locaux vers le pouvoir central et le second, de l’extérieur vers l’intérieur de l’espace délimitant la collectivité.
Dans cette contribution, nous avançons l’idée selon laquelle la thèse de la double primauté défendue par Abane au Congrès de la Soummam correspond parfaitement au mouvement du double transfert de souveraineté ayant fondé les processus de construction de l’Etat-nation en Europe de l’Ouest.
Notre démarche ne procède pas d’une hypothèse purement spéculative ou d’une lecture régressive de l’histoire. Elle s’appuie sur un décryptage des référents «abaniens» à la lumière de la contingence du moment et des évolutions ultérieures.
PRÉCAUTION SÉMANTIQUE
Toute démarche discursive commande au préalable de préciser le sens à mettre derrière les mots. Les notions de politique, militaire, intérieur et extérieur ne doivent pas être entendues dans le cadre étroit de la spécialisation fonctionnelle. Dans son livre Courrier Alger-Le Caire : 1954-1956, Mebrouk Belhocine, acteur et fin observateur du moment, a déjà esquissé une opinion dans ce sens.
Ces notions vont au-delà des hommes et des structures qui les incarnent. Elles expriment des catégories interdépendantes participant du processus de construction de l’Etat-nation. Une articulation donnée de ces instances préfigure une nature donnée de l’Etat-nation en gestation. Enfin, détaché de l’économie globale du texte de la plate-forme, le principe de la double primauté perdrait son sens.
LA PRIMAUTÉ DU POLITIQUE SUR LE MILITAIRE
Le politique désigne la volonté et la capacité de concevoir et de réaliser des projets collectifs. Il constitue le cœur même du «vivre ensemble». Pour le colonisateur, dont l’idéologie se fonde sur l’opposition civilisation/barbarie, le colonisé ne peut pas avoir de volonté ni de capacité. Il n’a pas à concevoir ni à réaliser. Il est exclu du politique et par suite du vivre ensemble. Aussi et en situation de colonisation, circonstance historique exceptionnelle, le politique, du point de vue du colonisé, interroge d’abord les conditions de possibilité du politique. La conscience collective naît de cette exigence de liberté, d’indépendance. Le projet commun premier est fondateur : il consiste à proclamer l’existence de la collectivité nationale et à montrer une volonté unitaire d’émancipation.
Mais dans la réalité concrète, d’énormes difficultés se dressent devant la réalisation de cet idéal. L’une d’elles, et non des moindres, est la problématique de la centralité.
Dans son livre L’Algérie et son destin, Mohamed Harbi dresse un état des lieux des forces de la Révolution à la veille du Congrès et met en évidence leur mode singulier d’organisation : les factions. Il écrit : «Elles ont leurs sources dans des appareils qui gèrent les ressources de la Révolution, mais qui, pour se donner une assise, tentent d’attirer des clientèles sur une base régionale et les font participer, sous des formes diverses, aux miettes du festin. Chaque faction a ses cadres politiques, ses organes de surveillance, ses idéologues. La logique qui les anime ne ressemble pas à celle d’un parti. L’appropriation de l’appareil est au cœur des conflits. Ce système annonce la mise en place d’un Etat basé sur les réseaux de clientèles».
Les factions sont bel et bien des micro-pouvoirs dotés de tous les attributs d’un Etat. Le sens réel du principe de la primauté du politique sur le militaire est la récupération des fragments de souveraineté répartis entre les différentes factions, les placer dans une institution unique et clairement identifiée, et enfin réorganiser la Révolution à partir de ce centre.
L’assassinat de Abane consacrera définitivement la principe de la légitimation par la violence. La militarisation de l’Etat est sur rail. Lorsque des années plus tard la politisation de la religion atteint son apogée, la confrontation des deux légitimités se fera par les armes. Le pays basculera dans un drame sans précédent.
LA PRIMAUTÉ DE L’INTÉRIEUR SUR L’EXT ÉRIEUR
La Révolution algérienne a suscité un large mouvement de sympathie et de solidarité de par le monde. Notre intérêt se portera particulièrement sur le cas de l’Egypte, car il s’agit en l’espèce d’un exemple paradigmatique de la conflictualité intérieur/extérieur. Il nous permettra, du coup, de mettre en lumière la portée de la seconde primauté consacrée dans la plate-forme de la Soummam.
Certains historiens, délibérément ou sous l’effet du terrorisme idéologique, ont magnifié l’action de l’Egypte en faveur de la Révolution algérienne et passé sous silence tous les faits susceptibles de révéler des velléités de caporalisation. En réalité, le soutien de l’Egypte a été flottant et souvent intéressé.
Le rapport de l’Egypte à la Révolution algérienne procède de l’idée selon laquelle la révolution égyptienne du 23 juillet 1952, c’est-à-dire le coup d’Etat des officiers libres, est le moment fondateur ayant marqué la résurgence du monde arabe sur la scène internationale. La pensée et l’action égyptiennes sont construites sur la base de ce postulat. A la lumière de ce prisme, la Révolution algérienne doit être regardée comme une simple manifestation, une émanation de la grande Révolution égyptienne. Et à ce titre, elle est dans l’obligation d’en porter la marque idéologique, d’accepter le droit de regard de l’Egypte et de subordonner ses objectifs aux intérêts de ce même pays. En termes clairs, il est demandé à l’Algérie de se contenter d’être une province égyptienne.
Dans le quatrième numéro de la revue Naqd parue en 1993, Gilbert Meynier propose une lecture du livre-mémoires de Fathi Dib. Dans cet article, l’auteur met en évidence de façon magistrale et solidement étayée le rapport réel de l’Egypte à la Révolution algérienne ainsi des desseins cachés du président Nasser. Le pouvoir égyptien s’est insinué dans les profondeurs du jeu factionnel algérien au point d’en devenir une faction à part entière, si ce n’est la plus forte. Il fera sienne la politique de division de la France et pèsera de tout son poids pour propulser Ben Bella comme leader de la Révolution. Dans l’article de Meynier cité précédemment, on peut lire : «La distribution des armes était décidée selon des critères laissés à la discrétion de Ben Bella».
Après la clôture des travaux du congrès d’Ifri, les responsables égyptiens iront encore plus loin. Ils plaideront, toujours selon Meynier, la réconciliation entre Ben Bella et Messali pour pouvoir réduire l’influence des chefs de l’intérieur considérés comme intraitables.
Le pouvoir égyptien ne soutient une décision de la Révolution que s’il a au préalable été consulté et donné son aval. Pour ne pas avoir été associé à la création et à la proclamation du GPRA, le pouvoir égyptien montrera au départ une nette hostilité. En 1958, il apporta aide et assurance à Lamouri et ses insurgés dans leur projet de renverser le gouvernement provisoire.
Par ailleurs, la volonté du pouvoir égyptien de subordonner la Révolution algérienne aux intérêts de l’Egypte n’est pas une vue de l’esprit. Dans son ouvrage 1956, Suez, Marc Ferro révèle :
«En octobre 1956, par exemple, certains nationalistes jugent que le départ de l’Athos, chargé d’armes, à destination de l’Oranie, a autant pour objectif de détourner les Français de leur projet d’expédition d’Egypte, en ouvrant ce nouveau ‘‘front’’, que d’aider réellement le mouvement national».
Enfin, les efforts de l’Egypte pour arracher l’Algérie à son espace régional naturel, le Maghreb, ont été incessants et insistants.
Bref, le rappel de ces quelques péripéties met bien en évidence le risque d’une mise sous tutelle extérieure de la Révolution à partir de dirigeants prédisposés à l’arrangement en raison d’une ambition à réaliser, d’une autorité à affirmer ou d’une haine à assouvir.
La Plate-forme de la Soummam vient à point nommé mettre un terme aux idées aventureuses des uns et aux velléités des autres. Le rapport de la Révolution à l’international a été défini avec précision dans toutes ses dimensions et ses moindres contours. Une phrase retiendra l’attention de Nasser : «La Révolution algérienne n’est inféodée ni au Caire, ni à Paris, ni à Moscou, ni à New York». Nasser y verra un geste irrévérencieux.
L’arrestation de Ben Bella suite à l’arraisonnement de l’avion transportant les dirigeants du FLN va lourdement peser sur le destin de Abane. Sa liquidation est désormais inévitable. Prémédité et exécuté de la manière la plus basse, ce crime est encore plus abject au regard du déni de vérité qui l’a accompagné.
LE DÉNI DE VÉRITÉ
Le déni de vérité n’est pas le refus de la vérité. Il va au-delà de la dissimulation. Son premier avantage est d’offrir en permanence au pouvoir en place l’opportunité de décliner la vérité selon les impératifs du moment. Pour délégitimer le GPRA, Ben Bella, alors président de la République, s’est fendu des propos suivants lors d’un meeting tenu le 1er octobre 1963 : «Il y a des gens ici qui connaissent le camp de Khemisset, en Tunisie. Quelqu’un qui s’appelle Boussouf y a tué des milliers de personnes. Il y a aussi des gens ici qui savent que notre gouvernement à Tunis a rempli des cimetières entiers des meilleurs cadres de l’Algérie. Ils ont été tués parce qu’ils n’étaient pas d’accord avec lui.
On a dit aussi qu’Abane a été tué au cours d’une bataille. Savez-vous comment il a été tué ? Il a été étranglé par les mains de ces criminels. Abane est mort étranglé par les mains des criminels du GPRA. Je peux vous parler pendant dix heures sur de pareils agissements, mais je ne donnerai qu’un exemple. Récemment, il y a deux mois seulement, notre ambassadeur à Tunis a découvert 180 millions de francs cachés dans un coin de l’ambassade. Est-ce que des gens pareils méritent une responsabilité ? Je pense que ces gens ont caché de pareilles sommes dans chaque coin.»
Pour rappel, Abane a été assassiné en décembre 1957 et le GPRA proclamé en septembre 1958. Ben Bella prend un peu trop de liberté avec le calendrier. Par ailleurs, le déni de vérité crée des obligations et impose des attitudes. Le 1er août 1923 Hitler déclarait : «Il n’y a que deux choses qui puissent unir les hommes : des idéaux communs et des crimes communs.»
Enfin, le déni de vérité sert à sceller une alliance sacrée, arracher une allégeance, écarter un rival, peser sur les représentations sociales, exercer un chantage, créer un climat de suspicion et de peur ; bref, il est consubstantiel à l’autoritarisme. Aussi, il est indissociable des autres dénis : déni de justice, de liberté, d’identité, de mémoire, etc. Ces dénis sont dans une relation étroite et solidaire. Leur synthèse est cette notion forte et éloquente que la vox populi désigne par hogra. Elle est sans équivalent en langue française. C’est un mélange de répression, privation, humiliation, inégalité, injustice, défiance, arrogance, dévalorisation et stigmatisation. Le mot hogra exprime à lui seul la puissance expressive et la grande aptitude à la synthèse de l’arabe algérien. Les animateurs du Printemps berbère de 1980 ont eu raison d’exiger, comme pour Tamazight, un statut de langue nationale et officielle pour l’arabe algérien.
La hogra n’est pas un effet de l’autoritarisme. Elle en est le fondement, la substance sans laquelle l’autoritarisme ne serait pas autoritarisme. Elle lui donne vie, elle le structure, façonne ses traits et lui garantit la longévité. De ce point de vue, la hogra est un transcendantal au sens kantien. En d’autres termes, tout découle et dérive de la hogra.
L’ALGÉRIE AUJOURD’HUI
Soixante ans nous séparent du Congrès de la Soummam. Malgré la distance, les problématiques d’alors restent pertinentes. Certes, le pays n’est plus sous régime colonial. Pour autant, il n’est pas ce havre de paix et de liberté tant rêvé et pour lequel se sont sacrifiés des millions d’Algériennes et d’Algériens. Loin s’en faut. La question de la souveraineté resurgit présentement avec fracas. En septembre 2015, nous écrivions dans les colonnes de ce même journal : «Des groupes informels de tous bords se posent en concurrents de l’Etat. Ils s’octroient des prérogatives régaliennes, édictent lois et codes et sévissent en toute impunité.
Le pouvoir de l’Etat se déplace graduellement vers ces micro-pouvoirs occultes. Sans existence légale, ces groupes possèdent néanmoins des prolongements dans les institutions où ils bénéficient de soutiens discrets et précieux. Entre ces groupes, des jonctions s’établissent et des alliances se tissent pour former une toile enveloppant l’Etat à la manière d’une pieuvre enserrant sa proie. Leur collusion avec des parties étrangères est avérée».
La mondialisation, surtout dans sa dimension financière, a favorisé les processus de privatisation des souverainetés nationales. En effet, les puissants du monde préfèrent avoir comme interlocuteurs des groupements d’intérêts plutôt que des Etats. Les économies dépendantes et sous régime autoritaire subissent de plein fouet cette évolution perverse du capitalisme international. De hauts responsables ne cachent plus leur affinité avec des parties étrangères et affichent parfois une allégeance ouvertement assumée. Les récents scandales ont révélé l’étendue du phénomène de corruption et sa connectivité avec des réseaux extérieurs. Des faits inédits dans une Algérie autrefois connue pour son attachement à la souveraineté et son sens élevé de la fierté nationale. Une symbolique s’est brisée.
La gravité de la situation ne semble pas préoccuper outre mesure nos gouvernants. Suspendus à l’espoir d’une hypothétique reprise des cours mondiaux du pétrole, ils se refusent à une juste caractérisation de la crise. La baisse du prix du baril est en réalité un révélateur et non le ressort de la crise.
Celle-ci est éminemment politique, et à ce titre elle recommande un traitement politique.
Sans culture ni savoir-faire et en déficit de légitimité, les décideurs sont terrifiés à l’idée d’une ouverture sur la société, la créativité, l’effort et la compétition politique saine et transparente. Ils s’accrochent désespérément et dangereusement aux modes de gestion, de sélection et de prélèvement autoritaires, leurs seuls domaines d’excellence.
De désastre à plus de désastre, de l’entêtement à plus d’entêtement, ils peinent à enrayer cette mécanique endiablée et sont emportés par l’inertie de leur propre faillite. Sans maîtrise aucune de la moindre évolution, ils se livrent pieds et poings liés à la loi de l’à-peu-près. En proie à une paranoïa avancée, ils menacent sans retenue, accusent sans preuve et condamnent sans procès.
Deux Algérie s’affrontent avec des armes inégales. D’un côté, l’Etat de hogra, et de l’autre, l’idéal de l’Etat de droit. En 1956, Abane et ses pairs ont formulé les conditions du passage de l’un à l’autre. La plate-forme de la Soummam est toujours d’actualité. Elle demeure une source d’inspiration inestimable et incontournable. Encore faut-il que s’exprime une volonté collective forte pour réinscrire le pays dans une dynamique moderne et progressiste. L’Algérie de demain sera à l’image de nos comportements d’aujourd’hui.
N’y a-t-il plus personne pour s’indigner sur un sursaut de patriotisme, un élan de dignité, voire même sur un malentendu, par erreur ?